Le dernier roman de l’écrivaine algérienne Maïssa Bey, Hizya, était apparu dans la deuxième sélection pour le prix Femina. Quel espace de liberté pour les femmes dans l’Algérie du XIXe siècle ? Comment l’écriture est-elle en soi un acte libérateur sur lequel on ne revient pas ? Entretien.
Au départ, il y avait un poème, un poème chanté que tous les Algériens connaissent, comme tous les Occidentaux connaissent Tristan et Yseult, ou Roméo et Juliette. Écrit à la fin du XIXe siècle, Hizya raconte la douleur d’un jeune homme qui pleure son amour perdu, la jeune et belle Hizya, qui vient de mourir dans ses bras. Comme beaucoup d’Algériens, Maïssa Bey a toujours aimé ce poème. Et puis un jour, elle se penche sur les mots.
« Ces mots-là m’ont éblouis, qui chantent et célèbrent le corps de la femme, se souvient-elle. On parle de ses seins, de ses cuisses, de sa chevelure… Il y a une forme d’adoration pour la femme, que l’on retrouve dans toute la poésie arabe. » Alors l’écrivaine de 65 ans, dont Hizya est le 16ème titre publié, se pose une question : « Est-ce que cela pourrait encore exister aujourd’hui chez nous, alors que l’on ne supporte pas de voir la moindre parcelle de peau dans la rue ? Qu’en est-il de la femme, à qui l’on doit les plus belles pages de la littérature arabe. »
Tel un clin d’oeil à tous ceux qui aiment cette histoire, Maïssa Bey imagine cette Hizya du XXIe siècle. Elle aussi rêve de trouver le grand amour, mais de toutes parts, son désir de vivre est freiné par ce que vivent les jeunes filles et les femmes d’aujourd’hui : le harcèlement, le regard des hommes, les interdits – qui viennent parfois d’autres femmes, comme sa mère. Et pourtant, la Hizya de Maïssa Bey ne veut rien d’autre que marcher tranquillement dans la rue, trouver quelqu’un avec qui discuter, ne pas avoir à se cacher, ne pas être contrainte au mensonge, à l’hypocrisie… Elle veut être naturellement femme. Et cela, aujourd’hui, en Algérie, c’est très dur.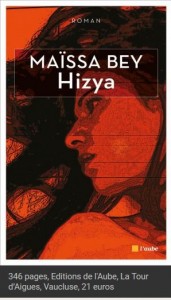
Mariée à un médecin, Maïssa Bey a longtemps enseigné le français à Sidi-Bel-Abbès (Nord Ouest du pays). Aujourd’hui, c’est là qu’elle vit et écrit, même si elle est souvent de passage à Paris, où vivent trois de ses quatre enfants. C’est là que nous l’avons rencontrée, peu après l’annonce de la sélection de Hizya au prix littéraire Femina.
Entretien et rencontre avec l’auteure
« Qu’est-ce qui pose problème dans cette présence des femmes, dans le corps des femmes ? »
Votre livre Hizya est-il le portrait de l’Algérie d’aujourd’hui ?
Ce n’est pas ce que j’ai voulu faire. J’ai voulu m’immerger dans une vie, voir comment les choses se présentent pour une jeune fille d’aujourd’hui. Mais plus j’avançais, plus je réalisais à quel point les horizons sont fermés. J’aimerais que l’on puisse, à la lecture de Hizya, se poser cette question : qu’est-ce qui peut être répréhensible dans le fait de marcher dans la rue cheveux au vent ? Qu’est-ce qui pose problème dans cette présence des femmes, dans le corps des femmes.
Vivre heureuse pour une femme libre, aujourd’hui, en Algérie, est-il possible ?
Les mots « femme libre », même en français, ont une connotation qui est avant tout liée aux moeurs. En Algérie, on ne peut pas concevoir une femme libre, c’est -à-dire détachée des codes, des conventions, des obligations, qui puisse user autrement de sa liberté qu’en couchant à droite, à gauche, ce qui donne une connotation somme toute très négative. Femme et liberté sont deux mots qui ont du mal à cohabiter… Même dans la langue française.
« C’est quoi une femme libre ? En gros, une pute, rien de moins, rien de plus. »
Maïssa Bey, dans Hizya
Pour être une femme vraiment libre, faut-il mieux être bien mariée et vivre sa liberté dans ce cadre-là ?
Dans Hizya, parmi d’autres portrait de femmes, il y a celles qui savent que le statut qui peut leur donner une certaine liberté, c’est celui de femme mariée. A partir de là, si elles savent choisir leur conjoint, si elles arrivent à s’épanouir au sein du couple, je pense que les femmes peuvent avoir ce sentiment de liberté.
Et vous?
La liberté, pour moi, c’est celle de faire des choix. La liberté de pouvoir choisir sa vie. De pouvoir choisir, le matin, comme l’on va s’habiller de s’asseoir à une terrasse de café sans attirer tous les regards. La liberté d’être invisible dans la rue. Ce serait le rêve, pour moi.
« Mon père s’est rué sur moi pour m’expliquer de façon très vigoureuse que la révolution s’arrête là où commence le droit les hommes, c’est-à-dire des individus de sexe masculin. »
Maïssa Bey, dans Hizya
Cet épisode entre le père et la fille, c’est votre histoire ?
Je n’ai pas connu mon père, ou très peu. Ce que je voulais dire, c’est que, après la guerre d’Algérie, on a pu croire, espérer, que les femmes gagneraient tout de suite les mêmes droits que les hommes. On a eu besoin des femmes pendant la guerre, et elles étaient volontaires. Mais une fois la guerre finie, on leur a demandé de rentrer chez elle.
Rien n’avait changé ?
On ne peut pas dire que les femmes sont rentrées dans les cuisines, en tout cas pas leurs filles, car quelque chose d’essentiel s’était produit pour le droit des femmes : en 1962, l’école est devenue gratuite et obligatoire pour tous. Auparavant, 98 % des femmes algériennes dites « indigènes » étaient illettrées. Mais dans les années 1960, la plupart des pères ont accepté que les filles s’engouffrent dans la brèche de l’éducation. Je fais partie de cette génération qui est allée le plus loin possible. Des femmes qui ont fait des études secondaires – c’est-à-dire après la puberté, ce qui est très important. Des femmes qui ont fait des études supérieures, et qui s’accrochaient pour réussir – souvent mieux que les garçons – et qui ont occupé, par leur talent et leurs compétences, cet espace public que l’on voulait leur reprendre.
N’y a-t-il pas eu un retour de bâton, depuis ?
Il est à nuancer. Les filles sont encore majoritaires dans toutes les universités – ce sont les statistiques qui le montrent. Hizya est licenciée, bien qu’elle vienne d’une famille très modeste, et sa soeur rêve d’être médecin. Cette piste-là est encore ouverte. Mais à quel prix ! Car le corps de la femme est devenu un enjeu. Autrefois, ce n’était pas du tout le cas. Quand je montre à mes filles des photos de moi à l’université, dans les années 1970, elles me disent : « Ce n’est pas possible, tu ne pouvais pas sortir comme ça ! » Et pourtant, je sortais habillée comme je voulais et cela ne choquait personne.
Ce qui me donne à espérer, dans notre pays, c’est cette formidable présence des femmes dans tous les métiers. Nous avons des femmes ministres, chef de département dans les universités, recteur… Mais les pouvoirs de décision sont très rarement attribués aux femmes, et c’est cela qui bloque l’émancipation des femmes.
Les mentalités ont régressé ?
Terriblement, sous couvert de retour aux « véritables » traditions et de religions. La présence de la femme dans l’espace public est remise en question. Pourtant, au prix de certaines « négociations », les filles arrivent à aller de plus en plus loin. On peut négocier le voile, par exemple. Paradoxalement, les filles des villages mettent le voile pour continuer leurs études. C’est un gage de respectabilité. Cela donne une forme de liberté.
« Écrire, c’est passer de l’autre côté du silence que l’on nous impose à nous, les femmes. » Maïssa Bey
Qu’est-ce qu’être femme et écrivain aujourd’hui en Algérie ?
C’est faire irruption dans l’espace publique qui devrait être réservé aux hommes. C’est bien sûr un acte politique, contre le silence qui nous est assigné dès notre naissance. Ce peut être considéré comme un acte de subversion.
J’ai commencé à écrire pendant les années noires (les années 1990 où s’opposaient le gouvernement et les groupes islamistes, ndlr), ces dix années qui ont endeuillé le pays et nous ont fait terriblement souffrir. Pour moi, l’écriture est alors devenue une nécessité. J’étais professeure de français, avec une position sociale très confortable, mais il m’était impossible de me cantonner à la position de témoin terrorisé. Ce que nous vivions était insupportable et il a fallu que je trouve des mots pour sortir du silence. J’ai dû prendre un pseudonyme pour bénéficier de la protection de l’anonymat et échapper à l’hécatombe qui frappait les journalistes, les créateurs… tous les esprits pensants. Je ne pouvais pas dire tout haut ce que mes livres disaient.
Qu’est-ce que l’écriture a changé dans votre vie personnelle ?
Jusqu’alors, je me consacrais à mes enfants, à mon métier. L’écriture a décalé la perception que j’avais de moi-même. Il a fallu que je me consacre à moi, ce qui est très dur pour une femme, qui est programmée pour s’occuper des autres.Pour la première fois, j’essayais de m’écouter, d’aller jusqu’au bout de ce que je voulais être, de la réalisation de quelque chose qui devient impérieux. Ce n’est pas très facile à vivre.
Comment l’écriture devient-elle impérieuse ?
Je ne pouvais plus me taire, je ne pouvais plus faire avec les compromissions, le silence, avec les obligations sociales et l’hypocrisie qu’elles génèrent. Cela me pesait de plus en plus. J’ai eu l’impression de me libérer de ce poids, de m’ébrouer, non seulement quand j’ai commencé à écrire, mais aussi quand j’ai commencé à être lue et entendue. Il y a eu une basculement entre l’anonymat, ce personnage social dans lequel je me contenais, et le dévoilement : « J’ai une voix, j’ai des mots pour dire les choses. J’essaie de les trouver, de les sortir de moi, parfois difficilement, et je vais les dire. » Se sentir exposée à la lumière, aux regards, au jugement, devenir un personnage public, c’est une étape très difficile à franchir. Mais aujourd’hui, c’est une part de moi-même à laquelle je ne renoncerai jamais.
Quand j’écris, je me demande souvent jusqu’où je peux aller : jusqu’aux derniers retranchements du silence ? Et j’y vais, car c’est mon unique espace de liberté. Si je devais reproduire dans l’écriture ce que nous subissons, nous femmes, dans la réalité du quotidien, j’arrêterais d’écrire.
Est-ce du courage ?
Je ne sais pas. Des événements ont affecté notre vie, à nous, citoyens algériens -l’islamisme, le terrorisme… Chez moi, et chez beaucoup d’autres, ils ont fait sauter les digues, et tout est passé, comme dans un élan irrépressible. Je me suis sentie emportée vers quelque chose de plus fort que moi, de nécessaire : dire les choses. Les femmes s’identifient plus facilement à mes romans, et beaucoup de femmes viennent me dire combien elles sont heureuses que je trouve les mots pour décrire leur détresse.
Que représente pour vous la sélection au prix Femina ?
Une immense surprise. C’est mon éditrice qui m’a envoyée un texto pour me l’annoncer. Moi qui croyais que les personnes qui font la sélection avaient leurs idées préconçues ! Et puis avec la quantité astronomique de livres qui sortent à la rentrée, je pensais que je serai noyée dans la masse. En tout cas, j’en suis très heureuse. C’est un premier pas vers la reconnaissance.
A relire sur les femmes en Algérie, dans Terriennes
> Viols, voiles, corps de femmes dans la Guerre d’Algérie
> Algérie-France, deux femmes gardiennes de mémoire
> Algérie : pour l’émancipation, destination désert
> Un photographe algérien s’est plongé dans l’intimité des Oranaises
> Le combat des Algériennes pour un nouveau code de la famille, entre féminisme et syndicalisme
> Didar Fawzy Rossano, révolutionnaire et internationaliste des XXème et XXIème siècles
> Portraits de femmes algériennes par Marc Garanger : « Elles m’ont foudroyé du regard »
> À Alger, sous le tunnel, confidences et coquetteries dans les toilettes pour dames
> Les Algériennes au miroir de l’élection présidentielle 2014

